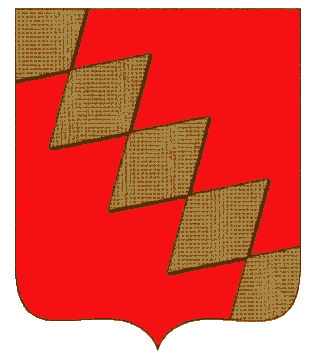
Un peu d'histoire de Ferques
|
|
Un peu d'histoire de Ferques
|
Pour trouver l'étymologie de Ferques, il faut remonter en des temps immémoriaux.
Selon Ducange, Ferctum est le nom d'une espèce de gâteau que les druides offraient à leur dieu ; Ferctor, celui du prêtre qui le consacrait; et Ferct, le nom de l'augure chargé de consulter le vol des oiseaux. Or, Ferques étant contigu à Landrethun où existait le Mollus ou le sanctuaire des druides ; le nom de ce village indique le lieu où se faisaient ces offrandes.
La paroisse de Ferques et Elinghen, Alias Ferquens Notre-Dame, est sous l'invocation de Saint-Pierre.
Comme antiquités celtiques, Ferques n'offre aux antiquaires que deux mottes, l'une près de la ferme qui en porte le nom, l'autre à peu de distance de l'église, près de la ferme de M. Battel. On y a trouvé des vases en terre cuite, qui sont perdus.
Le nom de Ferques apparaît pour la première fois dans l'histoire au commencement du XIIème siècle, dans la récapitulation des propriétés de l'abbaye d'Andres, par l'abbé Gislebert. On y lit que l'autel de Ferques, altare de Fercknes, déjà sous l'invocation de la Vierge Marie, faisait partie des églises dont l'abbaye avait le patronage. Elle le garda jusqu'à la Révolution.
Outre ce privilège qui lui fut confirmé par les bulles subséquentes des papes Pascal II, Calixte II, Innocent III, et par une charte de l'évêque de Thérouanne, Jean de Commines, l'abbaye d'Andres possédait à Ferques un domaine territorial en toute seigneurie, des vilains et des rentes. Une noble dame, nommée Maisendis, veuve de Hatton de Fercnes, avait donné à. St-Sauveur, à Sainte-Rictrude et à l'église d'Andres, pour l'âme de son père, celle de sa mère, de son mari et de son fils, Jean, un vavasseur qu'elle possédait et qui s'appelait Gauthier de Wadenthun. Vers le même temps, en 1134, Thicind, fille d'Heremar de Wadenthun, ses sœurs Oda et Dadilis, avec leur nièce Radwide, du consentement de leurs maris et de leurs enfants, accensèrent à l'abbaye d'Andres leur terre de Ferchenes, tenue jusque-là par Arnoul Frossard, sous la condition que l'abbaye leur paierait annuellement une redevance de sept sous six deniers, monnaie de Boulogne. Ce même Arnoul Frossard, ou Frussard, avec sa femme Agathe, désirant s'associer comme un frère et une soeur au petit troupeau de l'église d'Andres, lui avaient abandonné précédemment bon alleux de Ferques et d'Ardinxent, à la condition que l'abbaye se chargerait de leur entretien et de leur nourriture, tant qu'ils vivraient. Cette donation avait été faite sous l'évêque Jean de Commines, avant l'an 1130. Ils la renouvelèrent, en y ajoutant la moitié de la propriété du moulin de Guiptun, par un acte passé à Carly, en présence de l'évêque Milon 1er, durant cours de l'année 1133.
Hatton de Ferchenes, avec son fils Jean, et Baudouin, son parent, était un bienfaiteur de l'abbaye de Samer, à laquelle il avait laissé en pleine propriété des alleux situés à Ferques et mentionnés dans la bulle privilège d'Innocent III, de l'an 1199.
On connaît comme seigneur de ce village Gusfride de Fercnes, qui signe une charte d'Andres de 1116 et une charte de Saint-Bertin, de 1124. On ne doit point le confondre avec un autre Gusfride, son descendant, qui troubla l'abbaye d'Andres dans la jouissance de la dîme d'Hardinghen, comme nous l'avons vu plus haut. Jean de Ferchenes donna à l'abbaye de Beaulieu vingt arpents de terre, l'année de sa fondation. Raoul de Fercnes, cousin de Baudouin Palmarius, donna son assentiment à un acte de libéralité de ce dernier au mois d'avril 1215. Eustache de Ferkenes, s'inscrivit au nombre des bienfaiteurs de l'abbaye de Beaulieu en 1220. Il était fils de Gusfride II, et l'on retrouve son nom dans la notice consacrée au village de Leulinghen.
Deux autres personnages ont porté le nom du village de Ferques, pendant le cours du XII° siècle, et nous ne saurions les oublier. C'étaient le curé Simon de Fercnes, dont nous trouvons la signature au bas d'un acte de Gusfride II, en 1206 ; et le moine Henri de Fercnes, chapelain de l'abbé d'Andres, Pierre II, qui, voyant un mauvais sujet nornmé- Eustache Stinan, bâtard de Baudouin de Hames, lever sa massue pour assommer le prélat, se jeta résolument au devant du coup pour sauver la vie à son maître au dépens de la sienne.
Les religieux d'Andres avaient établi à Ferques, au centre de leurs diverses propriétés, une exploitation agricole (cartis) où ils donnaient aux paysans des environs l'exemple des meilleurs procédés de culture. Ils y donnaient aussi l'exemple de la patience dans les tribulations, qui ne leur manquaient pas. Leur métairie de Ferques, en effet, leur fut une fois confisquée et transformée en taverne par un moine émancipé, devenu le favori du comte de Flandre Philippe d'Alsace, qui l'avait tiré du monastère de Clairmarais pour le faire entrer dans l'abbaye de Lobbes ; mais il n'avait de moine que le nom. On le vit jusqu'à conduire en Angleterre l'armée de Flandre, moins pour faire une guerre régulière que pour la mener au pillage. Philippe l'avait envoyé à Rome en 1181 dans le but d'obtenir du pape, grâce à l'intervention de l'abbé d'Andres, la dispense nécessaire pour épouser en secondes noces la comtesse de Champagne, parente de sa première femme (cette mission n'eut pas de suite ; car pendant que les négociateurs étaient en route, Philippe changea d'avis). Si cet aventurier ne portait pas le nom de Guillaume, et n'avait pas joué à la cour de Flandre un rôle si prépondérant, on le prendrait pour le fils de notre Baudouin Busket. Il se mêlait de tout, s'ingérait partout, voulait être de toutes les intrigues. Dévoué corps et âme au comte Philippe, il ne jurait que par lui, et se servait de son nom pour faire faire à tout le monde ses volontés, et surtout pour empêcher qu'on ne divulguât ses méfaits. La chronique d'Andres affirme que le plus brave guerrier de cette époque, Ingelram de Fiennes, avait dû se soumettre aux caprices du moine Guillaume, à cause de l'influence qu'il exerçait sur le comte de Flandre. Le rusé personnage en profitait pour s'employer à toutes sortes de négoces et pour s'attirer toutes sortes de profits.
" Nous l'avons vu plus tard dans la paroisse de Ferques, dit l'abbé Guillaume, se mettre à la tête de notre curtis, détruite à son occasion, y faire vendre du pain et de l'excellente bière avec le secours de plusieurs filles de service (focarias) qu'il ne laissait pas chômer. Il faisait la même chose dans plusieurs curtes de l'abbaye de Lobbes ".
En 1286, le terrier de Beaulieu nous donne les noms des censitaires que cette abbaye possédait alors à Ferquenes, ils lui payaient des rentes en argent et des redevances en nature, consistant principalement en certaines mesures de froment et d'avoine, avec des oeufs, des glines et des oies.
Les Anglais ravagèrent le village de Ferques au commencement de l'année 1544, après avoir massacré dans leur église les gens d'Audinghen.
Ceux de Ferques paraissent avoir eu aussi pour refuge la tour de leur église, construction d'un genre particulier dont aucun antiquaire n'a su donner la date. On l'a démolie sans y trouver d'éclaircissement. La seule découverte qu'on y ait faite et dont les journaux ont parlé à tort et à travers, a été, celle de quelques monnaies d'or du XVI° siècle, cachées près du coussinet de la cloche dans une feuille de plomb. L'infortuné qui avait mis là son trésor en sûreté, est mort sans avoir pu aller l'y reprendre, ayant succombé sans doute sous les coups des ennemis de la France.
Ferques était dans le doyenné de Wissant, et ressortissait pour la justice au bailliage de cette ville. Elle a fait partie du canton d'Hardinghen, de 1790 à 1801
L'extraction du marbre et des pierres de stinkal dans les carrières du Haut-Banc, d'Elinghen et autres, a pris une extension considérable et occupe un très grand nombre d'ouvriers. Aussi, l'ancienne église étant insuffisante pour les besoins religieux de la paroisse, M. l'abbé Legault, en a-t-il fait construire une plus grande en 1868, avec l'aide de ses paroissiens et l'assistance des âmes pieuses. Le nouvel édifice qui mesure 37 mètres de longueur et 8 mètres 60 c. de largeur moyenne, a coûté environ 75,000 francs et a été élevé en briques et pierres, dans le style du XIII°, siècle, sur les dessins de M. N. Pichon, architecte à Boulogne, par M. Aug. Haîgneré, entrepreneur à Guînes. Elle possède un retable et des plaques de marbre de toutes les variétés du pays.
Le village d'Elinghen, qui forme une circonscription territoriale, déterminée par voie de tradition, a été autrefois une paroisse, distincte de celle de Ferques, à laquelle il se trouve réuni depuis un temps immémorial. Au rebours de plusieurs autres localités, elle ne formait pas une communauté civile et par conséquent elle n'avait point d'administration particulière, autre que celle des marguilliers de son église. Elinghem était une paroisse avant la Révolution, nommée Totingatum .En 1789 elle fut réunie à celle de Ferques, aussi, en 1789, la députation à l'assemblée électorale de Boulogne se présenta-t-elle au nom de la communauté entière d'Elinghen et Ferques où l'on comptait 73 feux; elle se composait de deux membres, qui étaient les sieurs Parenty et Delsaux dont on n'indique ni les qualités, ni la résidence.
Le hameau d'Elinghen est le lieu nommé Totingatum in fluvio wasconingwal adsitum donné, par Lebtrude à l'abbaye de St.-Bertin, en 808
L'autel d'Elingahem a été donné à l'abbaye d'Andres avec celui de Ferques, sous l'administration de l'abbé Gislebert, par un bienfaiteur inconnu. Les noms se suivent: Altare de Fercnes, allare de Elingahem, dans tous les documents de la chronique. On ne sait pas autre chose.
Elinghen se retrouve dans les chartes de Beaulieu, sous le nom d'Elingeham, comme je le dirai tout à l'heure en parlant des donations qui furent faites à cette abbaye par un seigneur du nom d'Aitrope, qui paraît avoir été possesseur de ce domaine.
On trouve dans le terrier de cette maison, la liste des nombreuses redevances qu'elle y possédait en 1286. Elle y avait " conté et segnorie haute et basse, hors mis les tenanches de mon segneur de Fienlles et mon segneur de Flamersele. "
On y remarque cette curiosité, que Jehans li Vaveseurs, au commandement et à la semonce de " Mon Segneur l'abei ", en redevance de son fief du Tertre, devait amener à Beaulieu un cheval à lui appartenant, du prix de soixante sous, harnaché, ferré, étant lui-même armé de l'écu et de la lance, comme on a coutume d'aller avec son lige seigneur en armée et en chevauchée au fer et au clou, aux dépens de " Mgr l'abei " et il était tenu de chevaucher avec lui pour aller aux chapitres assignés et autres lieux convenables, s'il plaît à l'abei, sa malle troussée.
Cet endroit pris de l'importance par suite de l'ouverture d'une fosse pour l'extraction du charbon ; mais les travaux d'extraction sont actuellement abandonnés.
On aperçoit sa petite église originale prés de la ligne de chemin de fer.
Comme tout village qui se respecte, Ferques dispose à sa périphérie de quelques hameaux :
Argencourt : En extrayant de la pierre, on y a découvert un cimetière mérovingien :
Dans la vallée d'Elinghen, sur la rive droite du chemin de fer de Boulogne à Calais, presque en face du moulin du Hure, avant d'arriver au bois de Beaulieu, se trouve une carrière de pierres, où M. Accarain, directeur de l'usine de Montataire (Oise), faisait extraire en 1868 de la dolomie pour les besoins de ses hauts fourneaux. Comme il arrive souvent en pareil cas, les ouvriers rencontrèrent des sépultures antiques. Les fouilles commencées le 25 mai, furent closes le 10 juin, avec peu de succès. Sur quarante deux sépultures, toutes avaient été pillées au moyen-âge et dépouillées de ce qu'elles pouvaient offrir d'intéressant. Dans les tombes de femmes il n'y avait plus rien que ça et là quelques grains d'ambre ou de verroteries, une bague et quelques styles en bronze, oubliés par les premiers chercheurs. Dans les fosses des hommes ont été trouvés deux umbos de boucliers, deux épées, une hache, huit lances, plusieurs scramasaxes , des couteaux des boucles de ceinturon en fer et en bronze, et quelques vases en terre. Tous ces objets ont été déposés au musée de Boulogne, dont les dévoués administrateurs s'attachaient alors à saisir toutes les occasions de compléter la riche collection mérovingienne de cet établissement.
Le Tertre : Fief dont le propriétaire Jehans il Vavesseurs devait au commandement de l'abbé de Beaulieu , comme redevance , "amener un cheval à lui appartenant du prix de soixante sous , harnaché , ferré , étant lui même armé de l'écu et de la lance comme on a coutume d'aller avec son lige seigneur en armées et en chevauchée " ;
La Pinterie ; fief aux Tellier ;
L'Engoule : lieu dit où le petit ruisseau de Ferques disparaît pour aller reparaître 2 kms plus loin ;
Lonquesticq : lieu dit cité dans le cartulaire de Beaulieu (1266 ) ; signifie longue pièce .C'est de là que la famille Lonquéty tire son nom ;
Le Trou Sonnoy ;
Le Hure : moulin.

Le domaine de Beaulieu connu en 865 sous le nom de Bello-Loctis est situé au nord-est de Ferques. Ce village, ou si l'on veut, ce hameau, était une dépendance du domaine de Fiennes dans la paroisse d'Elinghen. D'après le récit de Lambert d'Ardres, Eustache le Vieil, seigneur de Fiennes, voyant les nobles de son voisinage animés d'un grand zèle pour la fondation de divers monastères, résolut d'en établir un sur ses terres. Il s'y trouvait, en outre, engagé par le désir de sauver son âme, celle de ses prédécesseurs et de ses successeurs, avec le désir de racheter l'âme d'un seigneur de Ponches en Ponthieu qu'il avait tué dans un tournoi. D'autres ont ajouté qu'étant allé à la croisade il avait rapporté de l'Orient le calice dont Notre-Seigneur s'était servi pour faire la cène, et qu'il voulait en confier la garde à un établissement religieux, chargé spécialement d'honorer cette précieuse relique, si célèbre au moyen-âge sous le nom de Saint-Graal. Ce dernier motif n'ayant été mis en avant qu'assez tard, dans le cours du XVl° siècle, par l'abbé Folquin de Beaulieu, il n'y a pas lieu, de trop s'y arrêter. Disons seulement, d'après Lambert d'Ardres, que le fondateur de cette maison nouvelle, y mit des religieux Augustins, tirés, avec Guillaume, leur premier abbé, du monastère de Sainte-Marie-aux-Bois c'est-à-dire de Ruisseauville.
Lambert d'Ardres rapporte la fondation de l'abbaye de Beaulieu au règne de Guillaume II, comte de Boulogne, et à celui de Manassès, comte de Guînes. Ces deux synchronismes sont contradictoires. Manassès est mort en 1137, Guillaume II, ne ceignit la couronne qu'en 1153. Aussi, les historiens sont-ils partagés sur l'époque qu'il convient d'assigner aux commencements de cette communauté : les uns la mettent à l'an 1131, les autres la laissant flotter entre 1153 et 1160, limites extrêmes du règne de Guillaume II.
La première date (1131)est préférable (Dom Gosse, dans son Histoire d'Arrouaise (p. 353) dit que le rang occupé par l'abbaye de Beaulieu parmi les dépendances de cette congrégation, annonce une affiliation faite en 1137). Et d'abord, Lambert d'Ardres, historien des comtes de Guines, a dû errer plutôt sur la chronologie des comtes de Boulogne que sur celle des seigneurs dont il écrivait les annales. Puis, il existe une charte de l'an 1137, par laquelle un noble homme du comté de Boulogne Aitrope, avec sa femme Hadwide et son fils dont le nom n'est pas indiqué, donne à l'abbaye de Beaulieu toutes les terres, les bois, marais, censives et autres droits, qui lui appartenaient dans la paroisse d'Elinghen, à la charge d'une rente viagère de cinq marcs et trois fertings, au terme de Saint-Michel, et au poids de Boulogne, ad pondus Boloniense persolvendas. Après la mort du donateur, cette rente devait être réduite à cinq marcs seulement au profit de son héritier. Le comte Etienne ratifia cette donation par une charte passée la même année.
Ce même Aitrope, ou Eutrope, est cité comme ayant pris part, avec Eustache de Fiennes, à la fondation de cette abbaye; car, dans une note, écrite par un diplomatiste du XVII°siècle au dos de la charte de Guillaume II, publiée par M. de Marsy, les témoins qui ont souscrit à la fondation, furent Eustache du Four, Baudouin de Mortiers, Payen et Arnoul de Caffiers, Baudouin, clerc, Conon et Baudouin, vavasseurs d'Elinghen, et autres pour le comte de Fiennes, contradictoirement avec les témoins du seigneur Eutrope, qui n'est pas autrement connu.
L'établissement de Beaulieu périclita dès le principe. En effet, Guillaume d'Andres reproche aux moines Poitevins qui régissaient l'abbaye des comtes de Guînes, et en particulier à Gusfride leur abbé, de ne pas avoir accepté l'offre que leur fit Eustache de Fiennes, de soumettre sa nouvelle fondation à ce monastère, comme l'avait fait aussi Baudouin d'Ardres pour sa collégiale, avant de la mettre sous la dépendance de La Capelle.Mais le fait auquel fait allusion la chronique d'Andres, peut fort bien s'être passé lorsqu'il s'est agi de remplacer, soit par suite de son décès, soit pour quelque autre motif, le premier abbé de Baulieu. Gusfride a tenu la crosse de 1144 à 1157; et nous trouvons dans le Gallia Christiana, la mention d'une bulle d'Eugène III, aujourd'hui perdue, qui fut adressée en 1148 à Hugues, abbé de Beaulieu, successeur de Guillaume.
Ce fut le même Hugues, deuxième abbé de ce monastère, qui reçut aussi du Saint-Siège la nouvelle confirmation des biens de son établissement, que lui adressa le pape Adrien IV, sous la date du 4 janvier 1157. L'original de cette bulle, signée par le souverain-pontife lui-même et par cinq cardinaux, subsiste encore parmi les épaves échappées au naufrage des archives de Beaulieu que conserve la bibliothèque de Saint-Omer. On n'y trouve point expressément désigné le nom du fondateur, mais seulement celui des personnages qui ont contribué à la dotation. Eustache de Fiennes y figure à la tête de tous, et il semble bien que ce soit pour le fonds. Après lui viennent Warin de Lo, Gila de Kaieu, veuve de Conon de Fiennes, Guillaume son fils, Bernard de Bainghen, Eustache de Bezînghen, donateur de six setiers de froment à Embri, Hugues de Réty, un frère convers nommé Bernard, Baudouin d'Hermelinghen, Hugues de Colembert, Baudouin de Landrethun, Emeric du Temple, Jean de Ferques et autres trop vaguement dénommés pour être mentionnés ici.Il n'y est pas question d'Eutrope, ni des biens d'Elinghen; mais il y a une lacune d'une ligne, dans un pli du parchemin, au commencement de l'énumération des propriétés. D'ailleurs, la donation faite en 1137, par Aitrope, sous la charge d'une redevance de cinq marcq trois quarts a sans doute paru trop onéreuse; car ce seigneur la renouvela dans la suite, ainsi que nous l'apprenons d'une charte sans date de Guillaume II, comte de Boulogne, publiée par M. de Marsy, de Compiègne, dans le Bulletin de la Société des Antiquaires de la Morinie. L'objet de l'acte reconnu par le comte Guillaume, est le même que celui de 1137, énoncé plus haut. Seulement, la redevance stipulée comme rente viagère par le donateur n'est plus que de deux marcs, payables dans l'octave de la Pentecôte, à. Merch où il résidait. Une note ancienne, écrite au dos de cette pièce, dit que l'évêque Milon de Thérouanne confirma cette libéralité en 1157, ce qui nous fait connaître approximativement l'époque où elle eut lieu. L'abbé Gusfride d'Andres y apposa sa signature, en la compagnie d'un de ses religieux nommé Rainulfe.
Malgré ces donations l'abbaye de Beaulieu ne fut jamais un établissement bien considérable. Néanmoins, son domaine, à la fin du XIII° siècle, était assez étendu. Nous avons encore, en un rouleau de parchemin, long de 3 mètres 50., le terrier de ses tenanches, de ses rentes et de ses droitures, dressé en 1286, et nous y remarquons les noms des villages d'Elinghen, Ferques, Landrethun et Moyecques, Caffiers, Fiennes, Hermelinghen, Boursin, Hardinghen, Réty, Rinxent et Hydrequent, Raventun, Offrethun, Marquise et Baudrethun, Leulinghen, Wierre-Effroy, Bancres, etc. En fait de patronage d'églises, je ne crois pas qu'elle en ait jamais eu d'autre que celui de Tardinghen. Quant à ses dîmes, celles dont elle jouissait encore au dernier siècle étaient d'un ordre tout à fait secondaire, dans les paroisses de Caffiers, Hardinghen, Hesdres, Hydrequent, Leubringhen, Lottinghen, Wierre-Effroy et Wimille.
La comtesse Mahaut de Boulogne dota l'abbaye de Beaulieu d'une chapellenie, à laquelle elle attribua une rente de 96 rasières d'avoine.
L'instabilité des choses humaines est telle, même pendant les siècles auxquels on donne le nom d'âges de foi, que, la fondation faite à perpétuité par Eustache de Fiennes eut peine à durer deux cents ans. En effet, le 6 mai de l'an 1347, Annibal Ceccano, cardinal évêque de Tusculum, nonce du pape en France, était obligé d'accorder aux moines de Beaulieu, par une lettre datée du monastère de Saint-Josse, un délai de six mois pour acquitter le droit de procuration qu'ils devaient au Saint-Siège et dont il y avait deux années d'échues. Il est dit dans cet acte, que tous les biens de l'abbaye avaient été dévastés par les guerres., que leur maison avait été brûlée, et que l'abbé aussi bien que ses religieux se trouvaient réduits à mendier. Ce fut bien pis, quand les Anglais se furent rendus maîtres de Calais. Une note, consignée dans un ancien martyrologe, nous apprend que " la paix ayant été rompue en 1369, la guerre se ralluma entre les rois de France et d'Angleterre, et que, par suite, en l'an 1390, la veille de Sainte-Marie-Madeleine, c'est-à-dire le 21 juillet, l'abbaye de Beaulieu fut prise et détruite par les Anglais ".
A partir de cette époque, elle ne paraît plus avoir été habitée autrement que par un fermier qui en faisait valoir les revenus, et par un chapelain qui en acquittait les fondations religieuses, en continuant de prier pour l'âme des bienfaiteurs; mais il y eut toujours un abbé, qui ne résidait pas, et qui succédait en qualité de commendataire aux anciens abbés réguliers.
Certains pensent qu'avant 1544 et le saccage de Fiennes et de Ferques par les Anglais, un souterrain reliait l'abbaye au château de Fiennes. Au XVII° siècle l'abbaye fut restaurée.

|
|